
Le Hajj à La Mecque a rassemblé en trois jours, en 2024, près de 2 millions de pèlerins, dont 80% d’étrangers et a malheureusement enregistré un millier de décès parmi eux - DepositPhotos.com, Muhur
Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 133€ TTC par an.
Le décès du pape François en pleine période de Pâques et année du Jubilé a focalisé l’attention des médias sur Rome, le Vatican et l’enterrement d’un personnage majeur pour l’église et l’ensemble de la chrétienté, dont la disparition constitue régulièrement un événement planétaire.
Retransmis sur des milliers de médias à travers le monde, l’événement a aussi rassemblé quelque 400 000 fidèles, dont certains étaient d’ores et déjà présents dans la capitale italienne, alors que d’autres s’y sont déplacés spécialement pour confirmer leur foi et leur attachement à un homme qui incarne en plus de ses qualités humaines, un symbole.
Celui d’un monde où la religion et le religieux constituent une dynamique parallèle au développement économique et aux excès de la géopolitique.
Parallèlement, notons que dans la plupart des pays, les fêtes pascales (et les autres) sont l’occasion de grands rendez-vous, messes, prières, pèlerinages, retraites, veillées… attirant non seulement des pratiquants, mais aussi un public éloigné de la religion mais néanmoins sensible à ces rites majeurs.
Le paradoxe religieux : plus de fidèles mais moins de pratiquants
Les grandes religions enregistrent toutes un déclin des pratiques mais la démographie aidant, dans un monde passant de 8 milliards à 10 milliards d’habitants en 2050, elles comptabilisent plus de fidèles.
Notamment les deux religions majeures que sont le christianisme et l’islam. Leur progression sera d’autant plus importante que l’on considère que dans 25 ans, le nombre de chrétiens aura augmenté, mais lentement. Alors que le nombre de musulmans augmentera aussi mais beaucoup plus rapidement.
On devrait donc assister à un partage de l’humanité entre ces deux religions qui seront presque égales en nombre, atteignant chacune environ un tiers de la population mondiale.
Selon le Pew Research, on obtiendrait le résultat suivant : en 2050, sur une population mondiale de près de 10 milliards de personnes, il y aurait 2,8 milliards de chrétiens et 2,9 milliards de musulmans.
Les hindouistes se stabiliseront autour d’1,4 milliard, mais la population musulmane en Inde sera la plus importante de tous les pays du monde. Elle dépassera celle de l’Indonésie.
Les bouddhistes ne seront que 500 millions environ, à cause d’une démographie faible. Les juifs, pour leur part, devraient voir leur nombre osciller entre 16 et 20 millions.
Les animistes et autres croyances pourraient être environ 400 millions.
Les athées, les agnostiques et les autres personnes qui n'adhèrent à aucune religion - bien qu'en augmentation dans des pays comme les États-Unis et la France - représenteront une part décroissante de la population mondiale totale, soit un peu plus d’un milliard de personnes.
Quelques autres chiffres marquants :
- En Europe, les musulmans représenteront 10% de la population totale.
- Aux États-Unis, les chrétiens passeront de plus de trois quarts de la population en 2010 à deux tiers en 2050.
- Quatre chrétiens sur dix dans le monde vivront en Afrique subsaharienne.
- La Chine devrait compter à peu près 50 millions de chrétiens et enregistrer une forte augmentation dans les années à venir.
Les bons scores du touriste religieux
Face à ces chiffres impressionnants, notons que les performances du tourisme religieux concernent toutes les religions et tous les continents.
Nul n’ignore que le Hajj à La Mecque a rassemblé en trois jours en 2024 près de 2 millions de pèlerins, dont 80% d’étrangers et a malheureusement enregistré un millier de décès parmi eux.
Fatima au Portugal voit défiler annuellement quelque 6 millions de fidèles dont beaucoup viennent du bout du monde.
Notre-Dame de Guadalupe au Mexique, où la vierge est apparue pour la première fois en 1541, elle, n’enregistre pas moins d’une vingtaine de millions de visiteurs chaque année.
Quant à Notre-Dame de Paris qui accueillait quelque 14 millions de visiteurs avant l’incendie, elle en comptabilise depuis sa réouverture environ 30 000 par jour !
Et que dire de Lourdes, avec ses 3 millions de visiteurs annuels ? Ou de la fête de la Kumbh Mela en Inde qui a lieu tous les 12 ans et bat aussi des records de fréquentation ? Cette année surtout, profitant d’un alignement favorable des planètes, le pèlerinage devrait accueillir quelque 400 millions d’hindouistes en 44 jours !
Encore plus probant, un petit lieu comme Notre-Dame de la médaille miraculeuse, rue du Bac à Paris (encore un témoin d’une apparition mariale) reçoit tous les ans environ 2 millions de visiteurs.
Tandis que les JMJ (Journées mondiales de la Jeunesse) attirent selon les villes et les années entre 200 et 300 000 participants lors des messes.
Enfin, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, de plus en plus populaires, déclarent avoir enregistré en 2023 : 446 000 marcheurs !
Quant au tourisme organisé par des agents de voyages spécialisés ou les départements voyage de magazines comme La Vie, la Croix ou le Pèlerin, il se porte plutôt bien grâce à une clientèle de fidèles très exigeants.
Lire aussi : Futuroscopie - Le tourisme religieux crée du sur tourisme, et ce n’est pas fini !
Nul n’ignore que le Hajj à La Mecque a rassemblé en trois jours en 2024 près de 2 millions de pèlerins, dont 80% d’étrangers et a malheureusement enregistré un millier de décès parmi eux.
Fatima au Portugal voit défiler annuellement quelque 6 millions de fidèles dont beaucoup viennent du bout du monde.
Notre-Dame de Guadalupe au Mexique, où la vierge est apparue pour la première fois en 1541, elle, n’enregistre pas moins d’une vingtaine de millions de visiteurs chaque année.
Quant à Notre-Dame de Paris qui accueillait quelque 14 millions de visiteurs avant l’incendie, elle en comptabilise depuis sa réouverture environ 30 000 par jour !
Et que dire de Lourdes, avec ses 3 millions de visiteurs annuels ? Ou de la fête de la Kumbh Mela en Inde qui a lieu tous les 12 ans et bat aussi des records de fréquentation ? Cette année surtout, profitant d’un alignement favorable des planètes, le pèlerinage devrait accueillir quelque 400 millions d’hindouistes en 44 jours !
Encore plus probant, un petit lieu comme Notre-Dame de la médaille miraculeuse, rue du Bac à Paris (encore un témoin d’une apparition mariale) reçoit tous les ans environ 2 millions de visiteurs.
Tandis que les JMJ (Journées mondiales de la Jeunesse) attirent selon les villes et les années entre 200 et 300 000 participants lors des messes.
Enfin, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, de plus en plus populaires, déclarent avoir enregistré en 2023 : 446 000 marcheurs !
Quant au tourisme organisé par des agents de voyages spécialisés ou les départements voyage de magazines comme La Vie, la Croix ou le Pèlerin, il se porte plutôt bien grâce à une clientèle de fidèles très exigeants.
Lire aussi : Futuroscopie - Le tourisme religieux crée du sur tourisme, et ce n’est pas fini !
Le touriste religieux : une mosaïque
Compte tenu de la diversité de l’offre qui se ventile entre pèlerinages et simples visites de sites (églises, abbayes, monastères, temples, mosquées, sanctuaires…) et toutes sortes de religions, les touristes religieux constituent une population éclectique qui n’attend pas les mêmes prestations. Nous en distinguons donc 3 catégories :
Les dilettantes : un tourisme de passage
Loin devant les autres catégories de touristes, le touriste informel qui entre dans une église ou un temple le temps d’y jeter un coup d’œil, constitue le groupe le plus nombreux. Ni pratiquant, ni croyant, il visite un monument ou participe à une messe ou un concert, par curiosité. Souvent athée ou en tout cas très peu au fait des fondements d’une religion, il se comporte néanmoins respectueusement et va jusqu’à allumer des cierges, donner des offrandes, participer à une cérémonie, acheter une brochure… Indispensable à la bonne santé d’un édifice religieux ou d’un site, ce tourisme devrait augmenter au rythme du nombre de touristes.
Les croyants : un tourisme cultuel
A l’inverse et à l’opposé du spectre, se situent les véritables fidèles. Ceux qui croient en Dieu, sont familiers des rites et prières, réclament silence et calme pour se recueillir ou assister à une messe et tout autre événement religieux. Très attentifs à l’environnement d’un lieu de culte, ils choisissent leurs destinations et leurs visites en fonction de l’offre cultuelle qui leur est faite. Ce sont aussi eux que l’on retrouve dans des voyages spécialisés en terre sainte ou autre destination permettant d’assouvir leur soif religieuse. Appartenant à toutes les classes sociales, mais plutôt conservateurs, ils ont cependant tendance à se raréfier en Occident mais sans doute pas dans des pays comme la Chine, la Corée, l’Amérique latine.
Les spécialistes : un tourisme culturel
Nombreux mais loin de dominer les publics du tourisme de religieux, les adeptes d’architecture, décoration, sculpture, statuaire… constituent une base solide de visiteurs venus à dessein découvrir un édifice sacré. Documenté, suivant volontiers des visites organisées pour lesquelles ils sont prêts à payer, ces spécialistes appartiennent à la grande famille du tourisme culturel et sont sensibles à sa mise en valeur. Aussi intéressés par des temples népalais que des chapelles orthodoxes, ils suivent volontiers des voyages organisés autour d’une thématique aussi culturelle que religieuse.
Les dilettantes : un tourisme de passage
Loin devant les autres catégories de touristes, le touriste informel qui entre dans une église ou un temple le temps d’y jeter un coup d’œil, constitue le groupe le plus nombreux. Ni pratiquant, ni croyant, il visite un monument ou participe à une messe ou un concert, par curiosité. Souvent athée ou en tout cas très peu au fait des fondements d’une religion, il se comporte néanmoins respectueusement et va jusqu’à allumer des cierges, donner des offrandes, participer à une cérémonie, acheter une brochure… Indispensable à la bonne santé d’un édifice religieux ou d’un site, ce tourisme devrait augmenter au rythme du nombre de touristes.
Les croyants : un tourisme cultuel
A l’inverse et à l’opposé du spectre, se situent les véritables fidèles. Ceux qui croient en Dieu, sont familiers des rites et prières, réclament silence et calme pour se recueillir ou assister à une messe et tout autre événement religieux. Très attentifs à l’environnement d’un lieu de culte, ils choisissent leurs destinations et leurs visites en fonction de l’offre cultuelle qui leur est faite. Ce sont aussi eux que l’on retrouve dans des voyages spécialisés en terre sainte ou autre destination permettant d’assouvir leur soif religieuse. Appartenant à toutes les classes sociales, mais plutôt conservateurs, ils ont cependant tendance à se raréfier en Occident mais sans doute pas dans des pays comme la Chine, la Corée, l’Amérique latine.
Les spécialistes : un tourisme culturel
Nombreux mais loin de dominer les publics du tourisme de religieux, les adeptes d’architecture, décoration, sculpture, statuaire… constituent une base solide de visiteurs venus à dessein découvrir un édifice sacré. Documenté, suivant volontiers des visites organisées pour lesquelles ils sont prêts à payer, ces spécialistes appartiennent à la grande famille du tourisme culturel et sont sensibles à sa mise en valeur. Aussi intéressés par des temples népalais que des chapelles orthodoxes, ils suivent volontiers des voyages organisés autour d’une thématique aussi culturelle que religieuse.
Et après ?
Rejoignant l’essor des disciplines et thérapies de développement personnel rangées dans le domaine du bien-être, il est clair que, malgré une baisse de la pratique religieuse, le tourisme religieux continuera de peser lourd.
Porteur de l’histoire de l’humanité, au croisement du tourisme de mémoire et culturel, il ne lui reste qu’à éviter de faire peser sur ses épaules la part indiscutable de scandales qui affaiblissent régulièrement l’Eglise. En particulier en France !
Porteur de l’histoire de l’humanité, au croisement du tourisme de mémoire et culturel, il ne lui reste qu’à éviter de faire peser sur ses épaules la part indiscutable de scandales qui affaiblissent régulièrement l’Eglise. En particulier en France !
Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.
Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.
Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com
Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.
Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com


























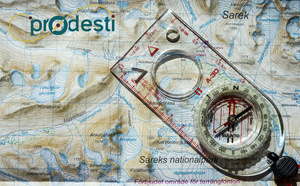











![Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO] Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/large_16_9/90083692-63590380.jpg?v=1753276654)















