
Tourisme et neurosciences : notre culture influence les aspects fondamentaux de notre psychisme qui sont la perception, la cognition et la personnalité́ Depositphotos.com Auteur Tiko0305
Premier point : les humains sont-ils déterminés par des constantes anthropologiques ? Leurs comportements sont-ils universels ? Certes, ils ont besoin de se nourrir, de se reproduire, de se protéger, de progresser, de mettre un pied devant l’autre... etc. Mais, pour la psychologie culturelle, la réponse est négative. Non, il n’y a pas de notion d’universalité́ derrière nos attitudes.
Donc, tous les touristes ne se comportent pas exactement de la même façon, que ce soit en face d’un tableau de Goya ou d’un coucher de soleil sur la mer des Caraïbes.
Pourquoi ? Parce que notre culture influence les aspects fondamentaux de notre psychisme qui sont la perception, la cognition et la personnalité́. Évident ? Disons qu’on le savait plus ou moins mais que l’on n’en avait pas la preuve.
Donc, tous les touristes ne se comportent pas exactement de la même façon, que ce soit en face d’un tableau de Goya ou d’un coucher de soleil sur la mer des Caraïbes.
Pourquoi ? Parce que notre culture influence les aspects fondamentaux de notre psychisme qui sont la perception, la cognition et la personnalité́. Évident ? Disons qu’on le savait plus ou moins mais que l’on n’en avait pas la preuve.


Pour 11,09€ TTC par mois*
profitez d'un contenu exclusif
*Soit 1 règlement de 133€ TTC par an
Vous êtes étudiant, cliquez ici
Vos données sont protégées et strictement destinées à l’usage interne de TourMaG.com.


























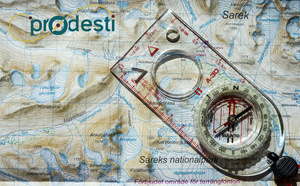










![Rock, blues, soul... des routes musicales pour oublier l'Amérique trumpiste [ABO] Rock, blues, soul... des routes musicales pour oublier l'Amérique trumpiste [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/large_16_9/88376487-62605087.jpg?v=1746540345)















