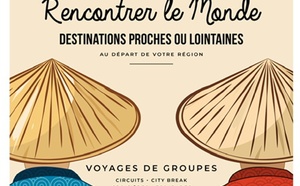366 millions de journées-skieurs ont été enregistrées dans le monde au cours de l'hiver 2023-2024 - Crédit photo : RP
Si les stations françaises ont majoritairement fermé leurs remontées mécaniques, en ce mois d'avril, et que les vacanciers se tournent désormais vers le littoral pour s'évader, pas question pour autant de tirer totalement le rideau sur les pistes et la montagne !
Les organisateurs du Salon international de l’aménagement en montagne, Mountain Planet, ont publié le nouveau Rapport International du Tourisme de Neige et de Montagne, présentant les chiffres de la saison 2023-2024.
"C'est une saison que je qualifierais de business as usual, saison 2. Globalement, nous restons dans la moyenne des 20 derniers hivers, a introduit Laurent Vanat, expert international de l’économie des stations de ski, en charge du rapport.
On constate que les pays, ayant connu de bonnes conditions de neige et une bonne météo, ont enregistré de bons résultats de fréquentation, tandis que ceux confrontés à des problèmes climatiques ont vu leur affluence baisser."
Si la montagne est toujours à la mode sur tous les continents, elle doit cette dynamique tout d'abord... au ski.
Non seulement l'activité attire massivement les visiteurs, mais en plus, elle est un levier marketing puissant, encore indétrôné.
Les organisateurs du Salon international de l’aménagement en montagne, Mountain Planet, ont publié le nouveau Rapport International du Tourisme de Neige et de Montagne, présentant les chiffres de la saison 2023-2024.
"C'est une saison que je qualifierais de business as usual, saison 2. Globalement, nous restons dans la moyenne des 20 derniers hivers, a introduit Laurent Vanat, expert international de l’économie des stations de ski, en charge du rapport.
On constate que les pays, ayant connu de bonnes conditions de neige et une bonne météo, ont enregistré de bons résultats de fréquentation, tandis que ceux confrontés à des problèmes climatiques ont vu leur affluence baisser."
Si la montagne est toujours à la mode sur tous les continents, elle doit cette dynamique tout d'abord... au ski.
Non seulement l'activité attire massivement les visiteurs, mais en plus, elle est un levier marketing puissant, encore indétrôné.
73% de la fréquentation mondiale réalisée par 13% des stations
Autres articles
-
 La décroissance, seul projet vraiment durable pour le tourisme ? [ABO]
La décroissance, seul projet vraiment durable pour le tourisme ? [ABO]
-
 Val Thorens enregistre une hausse de fréquentation
Val Thorens enregistre une hausse de fréquentation
-
 Belambra : une saison hivernale dynamique
Belambra : une saison hivernale dynamique
-
 Auvergne-Rhône-Alpes : quelle fréquentation en montagne cet hiver ?
Auvergne-Rhône-Alpes : quelle fréquentation en montagne cet hiver ?
-
 Vacances d’hiver 2025 : quel bilan pour les stations de ski françaises ?
Vacances d’hiver 2025 : quel bilan pour les stations de ski françaises ?
En tout, la saison passée, l'ensemble des stations de ski du monde entier ont enregistré 366 millions de journées-skieurs, selon l'indicateur de l'étude.
"Nous sommes à des niveaux comparables aux saisons précédentes, hors période Covid. D’ailleurs, nous constatons que la moyenne des journées-skieurs des 3 années post-crise sanitaire est même légèrement supérieure à celle pré-Covid. C'est une saison en dents de scie," poursuit l'expert.
Au total, 5 898 stations dans le monde sont actuellement recensées. Un chiffre en augmentation constante, car chaque année de nouvelles sortent de terre, comme cela a été le cas en Arménie ou en République tchèque.
Mais leur multiplication ne fait pas pour autant exploser la fréquentation mondiale.
Imaginez un peu que seulement 730 stations enregistrent plus de 100 000 journées-skieurs, donc 73% de la fréquentation est assurée par 13% des stations.
A lire : Vacances d’hiver 2025 : quel bilan pour les stations de ski françaises ?
"Nous sommes à des niveaux comparables aux saisons précédentes, hors période Covid. D’ailleurs, nous constatons que la moyenne des journées-skieurs des 3 années post-crise sanitaire est même légèrement supérieure à celle pré-Covid. C'est une saison en dents de scie," poursuit l'expert.
Au total, 5 898 stations dans le monde sont actuellement recensées. Un chiffre en augmentation constante, car chaque année de nouvelles sortent de terre, comme cela a été le cas en Arménie ou en République tchèque.
Mais leur multiplication ne fait pas pour autant exploser la fréquentation mondiale.
Imaginez un peu que seulement 730 stations enregistrent plus de 100 000 journées-skieurs, donc 73% de la fréquentation est assurée par 13% des stations.
A lire : Vacances d’hiver 2025 : quel bilan pour les stations de ski françaises ?
Montagne : les skieurs américains délaissent leurs stations pour l'Europe
Aux USA, le premier marché mondial du ski, avec plus de 60 millions de journées-skieurs durant l'hiver 2023-2024, la fréquentation recule en raison d'une année précédente tout simplement historique.
Il faut aussi souligner que si les Américains voyagent assez peu à l'étranger, la clientèle américaine montre un intérêt croissant pour le ski à l’étranger.
"Nous n'avons habituellement pas de skieurs états-uniens en Suisse et l'an passé, entre 250 000 et 300 000 journées-skieurs ont été enregistrées par des ressortissants américains.
Cette tendance se vérifie également dans d'autres pays alpins, comme en France, mais aussi dans des destinations plus lointaines, notamment au Japon.
Cette dynamique s'explique surtout par l’insatisfaction croissante des clients envers certaines grandes stations américaines," analyse Laurent Vanat.
Pour preuve, en 2020, une vidéo avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elle montrait une file d'attente monstre. Des centaines de skieurs s’agglutinaient devant un télésiège de la station américaine de Vail au Colorado.
S’ajoute à cela le coût astronomique de forfaits journaliers qui affichent parfois 250 ou même 300 dollars pour Vail.
D'ailleurs le site French Morning a démontré qu'il est plus avantageux pour un Américain de venir skier en France, au départ de New York, vol compris, que de se rendre dans l'une des plus grandes stations... de son propre pays !
"Un séjour en France sera deux à trois fois moins cher qu’aux États-Unis dans une station comparable. En mode low cost, la différence peut être plus importante encore.
S’il est possible de trouver des séjours « tout compris » en France pour environ 1 000$ par semaine en séjour « économique » (type UCPA par exemple), le seul forfait 6 jours vous coûtera plus cher aux États-Unis," conclut l'article.
Un excès tarifaire qui permet donc à l'Europe et aux autres pays d'attirer les voyageurs US amoureux de poudreuse. Ce n'est pas tout : différents méga-pass américains intègrent des domaines skiables européens et japonais.
Il faut aussi souligner que si les Américains voyagent assez peu à l'étranger, la clientèle américaine montre un intérêt croissant pour le ski à l’étranger.
"Nous n'avons habituellement pas de skieurs états-uniens en Suisse et l'an passé, entre 250 000 et 300 000 journées-skieurs ont été enregistrées par des ressortissants américains.
Cette tendance se vérifie également dans d'autres pays alpins, comme en France, mais aussi dans des destinations plus lointaines, notamment au Japon.
Cette dynamique s'explique surtout par l’insatisfaction croissante des clients envers certaines grandes stations américaines," analyse Laurent Vanat.
Pour preuve, en 2020, une vidéo avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elle montrait une file d'attente monstre. Des centaines de skieurs s’agglutinaient devant un télésiège de la station américaine de Vail au Colorado.
S’ajoute à cela le coût astronomique de forfaits journaliers qui affichent parfois 250 ou même 300 dollars pour Vail.
D'ailleurs le site French Morning a démontré qu'il est plus avantageux pour un Américain de venir skier en France, au départ de New York, vol compris, que de se rendre dans l'une des plus grandes stations... de son propre pays !
"Un séjour en France sera deux à trois fois moins cher qu’aux États-Unis dans une station comparable. En mode low cost, la différence peut être plus importante encore.
S’il est possible de trouver des séjours « tout compris » en France pour environ 1 000$ par semaine en séjour « économique » (type UCPA par exemple), le seul forfait 6 jours vous coûtera plus cher aux États-Unis," conclut l'article.
Un excès tarifaire qui permet donc à l'Europe et aux autres pays d'attirer les voyageurs US amoureux de poudreuse. Ce n'est pas tout : différents méga-pass américains intègrent des domaines skiables européens et japonais.
L'évaluation du réchauffement climatique sur la fréquentation
Derrière les USA, le 2e marché au monde n'est autre que... la France.
Notre pays a généré plus de 50 millions de journées-skieurs en 2023-2024, soit quelques millions de plus que l'Autriche.
En 4e position, nous retrouvons l'Italie devant le... Japon.
En forte croissance ces dernières années, la Botte affiche une vitalité "anachronique" par rapport à ses voisins. Celle-ci s'expliquerait par la modernisation continue des installations, des efforts marketing sensibles et aussi une sécurité de l'enneigement assez élevée.
S'il n'y a pas de grand chamboulement dans les classements, l'Europe de l'Est a connu une baisse de son activité, tout comme l'Australie, à cause d'un hiver trop doux. Le constat est le même en Allemagne, où les conditions météorologiques ont été mauvaises.
Les courbes vertes sont à chercher du côté de la Chine, de l'Italie et de l'Amérique du Sud.
"La Chine a connu avant la crise sanitaire une progression fulgurante dans le sillage des JO d'hiver de Pékin. L'année 2023-2024 a été historiquement la meilleure. Reste à savoir si le pays va retrouver une tendance aussi dynamique qu’avant Covid, ou si la courbe va désormais s’aplatir," poursuit Laurent Vanat.
Sur le long terme, la croissance mondiale du secteur devrait être alimentée par les seuls skieurs chinois qui découvrent depuis quelques années la pratique.
Dans ce pays qui s'éveille à la magie du ski, près de 50 stations indoor sont comptabilisées. Il est d'ailleurs l'un des rares marchés au monde où ce genre d'activité, sans être totalement négligeable, est pris en compte dans les statistiques.
Car les sports d'hiver en intérieur se développent aussi parce que la neige se fait de plus en plus rare.
"J'ai essayé d'évaluer l'impact du réchauffement climatique au niveau de la fréquentation. Je parle de fréquentation dans les massifs et je note une certaine résilience.
En plongeant le nez dans les résultats de la France ou de l'Autriche, il est compliqué de noter une réelle influence. Par contre la Suisse laisse penser qu'il existe un impact du réchauffement climatique sur la baisse des journées-skieurs," affirme l'expert suisse.
Notre pays a généré plus de 50 millions de journées-skieurs en 2023-2024, soit quelques millions de plus que l'Autriche.
En 4e position, nous retrouvons l'Italie devant le... Japon.
En forte croissance ces dernières années, la Botte affiche une vitalité "anachronique" par rapport à ses voisins. Celle-ci s'expliquerait par la modernisation continue des installations, des efforts marketing sensibles et aussi une sécurité de l'enneigement assez élevée.
S'il n'y a pas de grand chamboulement dans les classements, l'Europe de l'Est a connu une baisse de son activité, tout comme l'Australie, à cause d'un hiver trop doux. Le constat est le même en Allemagne, où les conditions météorologiques ont été mauvaises.
Les courbes vertes sont à chercher du côté de la Chine, de l'Italie et de l'Amérique du Sud.
"La Chine a connu avant la crise sanitaire une progression fulgurante dans le sillage des JO d'hiver de Pékin. L'année 2023-2024 a été historiquement la meilleure. Reste à savoir si le pays va retrouver une tendance aussi dynamique qu’avant Covid, ou si la courbe va désormais s’aplatir," poursuit Laurent Vanat.
Sur le long terme, la croissance mondiale du secteur devrait être alimentée par les seuls skieurs chinois qui découvrent depuis quelques années la pratique.
Dans ce pays qui s'éveille à la magie du ski, près de 50 stations indoor sont comptabilisées. Il est d'ailleurs l'un des rares marchés au monde où ce genre d'activité, sans être totalement négligeable, est pris en compte dans les statistiques.
Car les sports d'hiver en intérieur se développent aussi parce que la neige se fait de plus en plus rare.
"J'ai essayé d'évaluer l'impact du réchauffement climatique au niveau de la fréquentation. Je parle de fréquentation dans les massifs et je note une certaine résilience.
En plongeant le nez dans les résultats de la France ou de l'Autriche, il est compliqué de noter une réelle influence. Par contre la Suisse laisse penser qu'il existe un impact du réchauffement climatique sur la baisse des journées-skieurs," affirme l'expert suisse.
Ski : une hausse des forfaits de 13 à 19%
Dans la Confédération helvétique, la fréquentation est structurellement en baisse, excepté le regain d'intérêt depuis la sortie de la crise sanitaire.
"Nous avons la chance d'avoir suffisamment de détails pour analyser cette tendance. La baisse de la fréquentation sur les 15 dernières années s'explique par différents paramètres.
Tout d'abord 5% de ce total est imputable à la disparition de stations de ski. Puis, 39% des journées-skieurs ont disparu à cause de la réduction du nombre de jours d'exploitation dans la saison. Il est facile de faire le lien avec le réchauffement climatique," poursuit-il.
Les derniers pour cent s'expliquent par une baisse de la fréquentation moyenne journalière. Une réduction qu'il est possible de justifier par une modification de la consommation du ski ou encore une classe moyenne en perte de vitesse.
L'impact du réchauffement climatique et le changement des aspirations des voyageurs pourraient sans nul doute expliquer le retrait de l'activité française, inférieure à son niveau d’avant-pandémie.
Pour Laurent Vanat, l'explication réside plutôt dans le fait que certains massifs sont en retrait, sans plus d'explication. Nous savons que les Pyrénées par exemple ont connu des hivers délicats marqués par des périodes de sécheresse.
A bien y regarder, le climat n'est jamais très loin.
A lire : Réinventons la montagne : oui, mais comment ?
Toujours dans l'Hexagone, le rapport montre que la fréquentation étrangère représentait un peu moins de 30% du total la saison passée, alors qu'en Andorre, 90% des skieurs sont étrangers et plus de 50% en Autriche.
Si les sports d'hiver sont souvent assimilés à "des activités de riches", face à la montée des prix des matières premières, les forfaits ont vu leurs tarifs s'envoler de 13 à 19%, alors qu'en temps normal, l'inflation est plutôt de l'ordre de 3%.
"La perception des prix chers sur le marché démontre aussi que, finalement, nous assistons à une paupérisation et à une réduction de la classe moyenne en Europe.
Il n'existe pas de corrélation entre la hausse des tarifs et la pratique," estime l'auteur de l'Etude Internationale du Tourisme de Neige et de Montagne.
"Nous avons la chance d'avoir suffisamment de détails pour analyser cette tendance. La baisse de la fréquentation sur les 15 dernières années s'explique par différents paramètres.
Tout d'abord 5% de ce total est imputable à la disparition de stations de ski. Puis, 39% des journées-skieurs ont disparu à cause de la réduction du nombre de jours d'exploitation dans la saison. Il est facile de faire le lien avec le réchauffement climatique," poursuit-il.
Les derniers pour cent s'expliquent par une baisse de la fréquentation moyenne journalière. Une réduction qu'il est possible de justifier par une modification de la consommation du ski ou encore une classe moyenne en perte de vitesse.
L'impact du réchauffement climatique et le changement des aspirations des voyageurs pourraient sans nul doute expliquer le retrait de l'activité française, inférieure à son niveau d’avant-pandémie.
Pour Laurent Vanat, l'explication réside plutôt dans le fait que certains massifs sont en retrait, sans plus d'explication. Nous savons que les Pyrénées par exemple ont connu des hivers délicats marqués par des périodes de sécheresse.
A bien y regarder, le climat n'est jamais très loin.
A lire : Réinventons la montagne : oui, mais comment ?
Toujours dans l'Hexagone, le rapport montre que la fréquentation étrangère représentait un peu moins de 30% du total la saison passée, alors qu'en Andorre, 90% des skieurs sont étrangers et plus de 50% en Autriche.
Si les sports d'hiver sont souvent assimilés à "des activités de riches", face à la montée des prix des matières premières, les forfaits ont vu leurs tarifs s'envoler de 13 à 19%, alors qu'en temps normal, l'inflation est plutôt de l'ordre de 3%.
"La perception des prix chers sur le marché démontre aussi que, finalement, nous assistons à une paupérisation et à une réduction de la classe moyenne en Europe.
Il n'existe pas de corrélation entre la hausse des tarifs et la pratique," estime l'auteur de l'Etude Internationale du Tourisme de Neige et de Montagne.








 Publié par Romain Pommier
Publié par Romain Pommier 









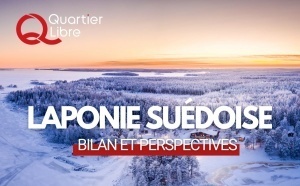
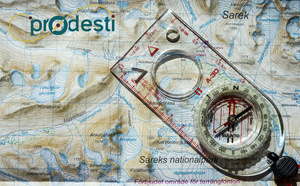









![Tourisme : où sont passés les Chinois ? [ABO] Tourisme : où sont passés les Chinois ? [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/large_16_9/87929923-62307593.jpg?v=1744721842)