L’entreprise française Sanofi-Pasteur, quant à elle, est un peu en retard sur ses concurrents, encore au stade des essais précliniques, mais semble suffisamment confiante pour lancer une production massive.
Pour faire le point, nous interrogeons Marie-Paule Kieny, vaccinologue. Directrice de recherche à l’Inserm, elle est présidente du comité Vaccin Covid-19 mis en place par les ministères de la Recherche et de la Santé pour évaluer les candidats-vaccin.
Différentes sociétés annoncent des taux d’efficacité de l’ordre de 90 %, voire 95 %, avez-vous été surprise ?
Marie-Paule Kieny : Ces taux d’efficacité ont été une excellente surprise pour tout le monde, notre communauté n’imaginait pas cet ordre de grandeur dès les premiers vaccins. Ce sont de très bonnes nouvelles. Cela nous permet d’envisager l’avenir avec optimisme, mais nous ignorons encore certains paramètres très importants.
Tout d’abord l’efficacité à long terme. Dans l’idéal un vaccin doit protéger longtemps contre une maladie, et si possible pour toute la vie comme le vaccin contre la fièvre jaune. À ce stade, nous ne pouvons pas prédire le taux de protection après 3, 6, 12 mois ou plus. Le chiffre devrait baisser, la question étant de savoir de quel facteur.
La deuxième interrogation, très importante : les personnes âgées seront-elles bien protégées ? En effet, les formes graves et les décès se comptent principalement dans cette population, or la réponse immunitaire y est souvent moins efficace. Cela pourrait donc baisser l’efficacité du vaccin. Les résultats préliminaires annoncés par les deux entreprises ne semblent pas indiquer de différences significatives selon l’âge, mais ces données restent à valider.
Nous attendons donc la publication des résultats complets des études dans des revues à comité de lecture pour pouvoir analyser finement les données de protection et de sécurité.
TC : Les vaccins Pfizer et Moderna reposent sur une nouvelle technologie, celle des vaccins à ARN, quelles en sont les spécificités ?
MPK : La plupart des vaccins consistent en l’administration d’un virus tué par un traitement chimique, d’une forme atténuée (non pathogène) de ce virus ou d’une petite partie de celui-ci : il est donc impossible à l’agent pathogène de se reproduire. Le but est de préparer une réponse immunitaire efficace en cas de contact avec le « vrai » virus.
La technologie des vaccins à ARN est différente : l’idée est ici d’injecter le matériel génétique du virus, puis nos cellules se chargeront de produire une ou plusieurs protéines virales, lesquelles seront reconnues par notre système immunitaire.
À lire aussi :
Comment fonctionne le vaccin à ARN de Pfizer ?
Un inconvénient de cette technologie est que la molécule d’ARN en elle-même est fragile, c’est pourquoi Pfizer préconise de conserver son vaccin à une température de -70 °C. Cela pose donc des problèmes logistiques importants, mais je rappelle que des congélateurs permettant d’atteindre ces températures sont des outils classiques dans les laboratoires de recherche, il ne me semble donc pas, qu’en France, cela soit un problème insurmontable. De son côté, Moderna a réussi à développer un vaccin stable plusieurs mois à -20 °C, et même 30 jours à la température d’un réfrigateur (4 °C), voire 12 heures à température ambiante. On peut espérer que les développements technologiques mis en œuvre par BioNTech et Pfizer permettront dans l’avenir d’atteindre des conditions de conservations semblables à celles annoncées par Moderna.
TC : Que savons-nous de la sécurité des vaccins ?
MPK : Pour le moment, les données de sécurité sont peu nombreuses. On connaît néanmoins la « réactogénicité » ou comment notre corps réagit à l’injection du vaccin : c’est le mal à la tête, la douleur ou le gonflement au niveau du bras, ou encore les nausées. On observe que les vaccins à ARNm sont assez réactogène, plus par exemple que les vaccins contre la grippe, cela restant acceptable.
Ce que l’on ignore encore, ce sont les effets secondaires à plus long terme, qui apparaîtront forcément à mesure que le nombre de personnes vaccinées augmentera et avec le temps.
Les autorités de santé seront très attentives à cela. Aux États-Unis, la FDA (Food and Drug Administration) a par exemple exigé que les entreprises fournissent ces données sur au moins la moitié de la cohorte vaccinée, soit environ 10 000 personnes, avec au moins deux mois de recul. Ce suivi continuera bien sûr, et on aura des données consolidées environ 6 mois après la vaccination.
TC : Pour quand peut-on espérer une mise sur le marché ?
MPK : Il faudra le feu vert des autorités de santé. BioNTech/Pfizer et Moderna devraient pouvoir fournir à la FDA ces données de sécurité à la fin du mois de novembre. On pourrait donc imaginer que si aucun élément problématique n’est relevé, l’autorisation de mise sur le marché arrive au mois de décembre.
Pour l’Europe, l’équivalent de la FDA est l’EMA (European Medecines Agency). Les procédures et les délais sont similaires. Une fois les autorisations délivrées, ce sera aux industriels d’être capables de fournir une énorme quantité de vaccins.
La France a déjà signé des accords avec quelques producteurs de vaccins de façon à avoir un portefeuille de vaccins. L’État a en effet préféré investir sur plus d’une technologie plutôt que de mettre « tous ses œufs dans le même panier. »
Les vaccinations pourraient donc commencer début janvier si tout se déroule comme prévu.
TC : Qui sera vacciné ?
MPK : En priorité, nous avons préconisé d’immuniser les soignants, sur la base du volontariat. C’est avant tout une obligation éthique : aidons ceux qui nous aident. Au-delà de cet aspect, notre système de soin a été mis à rude épreuve lors des deux vagues épidémiques. Il est donc indispensable que le maximum de personnel puisse être en bonne santé pour prendre soin des malades.
Il faudra dans un même temps s’occuper des personnes les plus susceptibles de déclencher une forme grave de la maladie, nous parlons donc des personnes âgées (de plus de 65 ans), des personnes de moins de 65 ans souffrant de pathologies chroniques (pathologies cardiovasculaires, hypertension, diabète) et des personnes atteintes d’obésité. Cela représente environ 25 % de la population française.![]()
Marie-Paule Kieny, Directrice de Recherche, Inserm
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.


























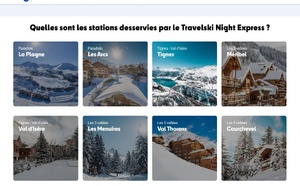



![Tourisme : où sont passés les Chinois ? [ABO] Tourisme : où sont passés les Chinois ? [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/large_16_9/87929923-62307593.jpg?v=1744721842)















